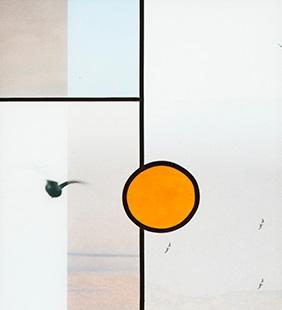
DIMANCHE 7 JUILLET 2024
HOMELIE DE GILLES
PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 2, 2-5)
En ces jours-là,
l’esprit vint en moi
et me fit tenir debout.
J’écoutai celui qui me parlait.
Il me dit :
« Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël,
vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi.
Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères
se sont soulevés contre moi.
Les fils ont le visage dur,
et le cœur obstiné ;
c’est à eux que je t’envoie.
Tu leur diras :
‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’
Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas
– c’est une engeance de rebelles ! –
ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux.
DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 12,7-10)
Frères,
les révélations que j’ai reçues
sont tellement extraordinaires
que, pour m’empêcher de me surestimer,
j’ai reçu dans ma chair une écharde,
un envoyé de Satan qui est là pour me gifler,
pour empêcher que je me surestime.
Par trois fois,
j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.
Mais il m’a déclaré :
« Ma grâce te suffit,
car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. »
C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses,
afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure.
C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ
les faiblesses, les insultes, les contraintes,
les persécutions et les situations angoissantes.
Car, lorsque je suis faible,
c’est alors que je suis fort.
ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6)
En ce temps-là,
Jésus se rendit dans son lieu d’origine,
et ses disciples le suivirent.
Le jour du sabbat,
il se mit à enseigner dans la synagogue.
De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient :
« D’où cela lui vient-il ?
Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée,
et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?
N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie,
et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?
Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? »
Et ils étaient profondément choqués à son sujet.
Jésus leur disait :
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays,
sa parenté et sa maison. »
Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ;
il guérit seulement quelques malades
en leur imposant les mains.
Et il s’étonna de leur manque de foi.
Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.
Homélie
Avant de devenir le prophète qu’on connait, Ezéchiel était un simple juif déporté à Babylone comme ses congénères. Et c’est du milieu du peuple qu’il est appelé à parler au nom de Dieu. Mais avant, il a besoin d’être remis sur pieds, car comme ses coreligionnaires, il était démoralisé et déprimé suite à l’exil. Alors l’Esprit de Dieu, le Souffle Saint va l’inviter à se remettre debout : au verset 1 (absent du texte de ce jour) il est dit : « Fils d’homme, tiens-toi debout, je vais te parler ». Puis L’Esprit de vie va l’aider à se remettre debout comme le précise Ezéchiel au V 2 : « À cette parole, l’Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait ». Magnifique alliance de l’homme et Dieu qui collaborent pour que l’homme soit debout.
Une fois debout, il va recevoir sa mission de prophète et Dieu ne lui cache pas les difficultés à venir : « c’est vers un peuple rebelle qui s’est révolté contre moi que je t’envoie, ils ont le visage dur et le cœur obstiné », bref, autant te prévenir, ça ne va pas être une partie de plaisir. Mais la réception du message n’est pas un souci pour Dieu : « qu’ils t’écoutent ou pas, l’important n’est pas là… l’essentiel, c’est que quelqu’un parle de moi au milieu de ce peuple en souffrance, alors ne t’inquiète pas de la manière dont sera reçu ton message, ça c’est mon affaire à moi. Toi tu parles et moi je m’occupe du reste ». C’est très apaisant de savoir cela quand nous témoignons de Dieu. Je n’ai pas à m’occuper de la façon dont le message sera reçu, mais uniquement de la manière dont je parle de Celui qui vit en moi.
Dans la seconde lecture, Paul va décrire une autre qualité essentielle à un prophète : l’humilité. Rappelez-vous, il reçoit de grandes intuitions, « des révélations tellement extraordinaires » qu’il court le risque « de prendre le melon » comme on le dirait aujourd’hui, c’est-à-dire de se vanter ou de s’enorgueillir de son statut de prophète. Mais justement, il en est empêché grâce à « une écharde » ! C’est une façon imagée pour dire que quelque chose le handicape, le gène ou lui fait mal. Personne ne sait ce que c’est précisément, un bégaiement ? une timidité ? un doute ? une faiblesse psychique ou physique ? … Qu’importe, c’est quelque chose qu’il aimerait bien ne pas avoir, et dont il a essayé de se débarrasser en demandant trois fois à Dieu de l’écarter de lui, mais la seule réponse qu’il ait obtenue c’est : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Il comprend alors que cette faiblesse ne gêne pas Dieu, au contraire, c’est par ses faiblesses que Dieu donne toute sa puissance, touche le cœur de ceux qui l’écoutent. Je trouve vraiment magnifique de savoir que nos faiblesses n’empêchent pas Dieu d’agir en nous et par nous, au contraire c’est grâce à elles qu’il œuvre dans le monde ! Tout l’évangile est là ! Oui l’humilité est la condition sine qua non pour que Dieu puisse œuvrer en nous !
Alors si vous avez parfois du mal à accueillir vos limites et vos faiblesses, relisez 2 Co 12, et dites-vous que vous êtes prêts pour être des messagers de Dieu, des prophètes par lesquels il veut parler au monde d’aujourd’hui. Comme Pierre le renégat, François d’Assise ou la petite Thérèse, de tout temps, Dieu a choisi des petits pour confondre ce qui est fort, riche et puissant.
Cela est valable aussi pour Jésus. Voilà pourquoi les habitants de Nazareth ont tant de mal à l’accueillir tel qu’il est : ils sont dans l’admiration de sa sagesse et des grands miracles qu’il réalise, ils le voient grand et fort et ne comprennent pas qu’il soit un simple charpentier, un homme parmi les autres hommes et « ils sont profondément choqués à son sujet » nous dit l’évangile. L’image toute simple et humble que Jésus leur renvoie ne rentre pas dans la conception habituelle qu’ils se font d’un prophète : ils se méprennent à son sujet, comme le dit Jésus : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Non pas qu’il ne soit pas aimé, mais il veut dire qu’il y a méprise à son sujet, qu’il n’est pas compris, « ils sont frappés d’étonnement » nous dit encore le texte, parce qu’ils attendent un autre type de prophète qui ne soit pas un simple charpentier ! Bref, comme ça ne rentre pas dans leur logiciel, ils ne peuvent pas recevoir la nouveauté qu’il apporte, ils sont fermés à l’inouï de Dieu, enfermés dans leur croyances ou leur savoir. (C’est la même remarque de Dieu à propos du peuple au temps du prophète Ezéchiel, rappelez-vous : « ils ont le visage dur et le cœur obstiné »)
Et c’est la raison pour laquelle il ne peut accomplir aucun miracle ce jour-là, car tant que ses auditeurs restent arcboutés sur leurs certitudes et leurs savoirs, ils sont pleins d’eux-mêmes et il n’y a plus de place pour Dieu en eux. Comme le disait Paul, il faut se reconnaitre faible pour que Dieu puisse agir en nous. Le texte précise qu’il put guérir seulement quelques malades (= quelques faibles), en leur imposant les mains, car ils se reconnaissaient faibles ; alors la grâce peut passer. Mais tous ceux qui se croyaient forts et pensaient savoir qui était Jésus, il ne peut rien accomplir avec eux. Voilà le grand enseignement de la parole de ce jour : la parole de Dieu relayée par Jésus ne s’adresse pas à nos têtes mais à nos cœurs, ce n’est pas un savoir à propos de Dieu mais un amour à accueillir alors, ne craignons pas notre petitesse, et soyons assez conscient de nos manques pour que Dieu puisse faire de nous sa demeure comme le suggère François d’assise dans ce succulent dialogue avec frère Léon :
Un jour François d'Assise cheminait en compagnie de frère Léon au bord d'un torrent. S'étant arrêté pour se reposer, frère Léon regardait longuement l'eau qui bondissait sur les rochers, toute blanche et exultante avec de brefs éclats d'azur. François le regarda et vit de la tristesse sur son visage :
- tu as l'air songeur, lui dit -il simplement.
- Ah si nous pouvions avoir un peu de cette pureté, répondit Léon, nous connaitrions nous aussi la joie folle et débordante de notre sœur l'eau.
Il passait dans ces paroles une profonde nostalgie et le regard de Léon fixait mélancoliquement le torrent qui ne cessait de fuir dans sa pureté insaisissable. Après un moment de silence, François posa à Léon cette question :
- sais-tu frère, ce qu'est la pureté du cœur ?
- oui, lui dit Léon sans hésiter, c'est de ne pas avoir de fautes à se reprocher
- alors je comprends ta tristesse, dit François, car on a toujours quelque chose à se reprocher.
- oui, reprit Léon et cela me fait désespérer d'arriver un jour à la pureté du cœur.
Alors, après un temps de silence François lui dit :
- frère Léon, ne te préoccupe donc pas tant de la pureté de ton cœur. Tourne ton regard vers Dieu, admire-le, réjouis-toi de ce qu'il est, lui, toute sainteté, rends-lui grâce à cause de lui-même c'est cela petit frère avoir le cœur pur.
- mais Dieu cependant réclame notre effort et notre fidélité, fit observer frère Léon
- oui, c'est vrai répondit François, mais la sainteté n'est pas un accomplissement de soi, ni une plénitude que l'on se donne. Elle est d'abord un vide que l'on découvre, que l'on accepte et que Dieu vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. Ne te demande pas où tu en es avec Dieu, demande-toi seulement si tu es assez conscient de tes manques pour que Dieu puisse faire de chez toi sa demeure. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé. En cela seulement, tu trouveras la paix et la sainteté.
Saint été à chacun et chacune d’entre vous.
Gilles Brocard
DIMANCHE 16 JUIN 2024
HOMELIE DE VENUSTE
Un dynamisme interne, mystérieux, invisible
Ezéchiel 17, 22-24 : avec l’épreuve de l’exil et tout le découragement qui s’en est suivi, le prophète a compris que Dieu seul peut relever son peuple. Il l’exprime par l’image du jeune rameau que Dieu lui-même plantera, qui deviendra un cèdre magnifique, produira des branches, portera du fruit et abritera toutes sortes d’oiseaux.
2 Corinthiens 5, 6-10 : la vie terrestre, « dans ce corps », est comprise comme un exil, loin du Seigneur. Exil ou pas, l’important est de plaire au Seigneur et de cheminer dans la foi, en pleine confiance.
Marc 4, 26-34 : le royaume de Dieu ne tarde pas à venir, il est en gestation. Il faudra du temps pour qu’il soit visible aux yeux de tous. Mais il arrivera aussi sûrement que la moisson à partir d’une minuscule graine de moutarde qui deviendra une plante assez robuste pour abriter les nids de plusieurs oiseaux du ciel.
Jésus parle du règne de Dieu. Il en parle en paraboles, en référence à la vie agricole : au miracle perpétuel de la vie, cette force irrésistible qui fait germer et grandir la graine semée, jusqu’à la moisson. Message d’espérance et d’optimisme à méditer alors que les statistiques de notre Eglise sont en chute libre et poussent certains à crier au catastrophisme. Jésus parle en paraboles dans une première annonce, « mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples », à ceux qui veulent aller plus loin dans l’approfondissement de la foi (groupes bibliques par exemple), comme le souhaite l’Eglise depuis toujours.
Que faut-il entendre par « Règne de Dieu » ou « Royaume de Dieu » (« Royaume des cieux » chez l’évangéliste Matthieu) avec majuscule ? C’est là où Dieu règne, là où « les enfants du Royaume » font la volonté du Père. « Règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, un règne de justice, d'amour et de paix » (préface de la fête du Christ-Roi). Ce règne n’est évidemment pas limité à la seule Eglise, puisque le Fils a le projet de rassembler toute l’humanité : l’Eglise est une partie du Royaume. Celui-ci n’est pas non plus uniquement spirituel, ni uniquement eschatologique (pour « les derniers temps ») : il est déjà là et il continue à se construire et à s’étendre. D’où la belle image du grain et de la semence : un dynamisme interne, mystérieux, invisible, mais une force que rien ne peut arrêter.
Les deux paraboles veulent faire comprendre que le Royaume de Dieu est une œuvre de Dieu qui ne peut que grandir, qu’on le veuille ou non, qu’on le voie ou non. Tout comme le miracle de la vie que tout un chacun peut admirer à travers champs et jardins. Le semeur ici c’est Dieu lui-même, le grain semé est justement le Règne de Dieu. Une fois dans la terre, la force de la vie est irrésistible ; nuit et jour, la vie germe et grandit « d’elle-même ». D’abord semence, elle devient herbe, donnera l’épi et enfin du blé plein l’épi. Au départ, le grain était unique et seul, à la moisson (au dernier jour), l’épi en sera plein de nombreux autres. « Si le grain de blé ne meurt, disait Jésus de sa mort, il demeure seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits. »
Une première remarque que les commentateurs font de ce passage d’évangile, c’est que, au temps où Marc écrit, les chrétiens se posent une grosse question. Le Seigneur avait dit que « cette » génération ne passera pas avant qu’il ne revienne pour établir son règne. Royaume attendu triomphal, rapide, spectaculaire. Alors pourquoi tarde-t-il, surtout qu’il y avait, à l’époque, un déferlement de persécutions atroces contre les chrétiens, comme si les puissances du mal prenaient le dessus. Royaume fantôme ? La réponse est dans la parabole : il faut attendre patiemment le temps de la moisson (terme biblique pour dire le jugement du dernier jour), comme l’agriculteur sait attendre le rythme des saisons, en faisant confiance aux lois de la nature. La moisson il y aura, mais en son temps. Rien ne sert de courir. Il en va de même pour le Royaume : il a son rythme… attendez voir sans désespérer, attendez la moisson abondante malgré les apparences, vous êtes en présence d’une force cachée, imperceptible mais toujours active et efficace qui arrive toujours à ses objectifs. Il faut être comme Jésus : des incorrigibles optimistes, malgré les vents contraires, malgré toutes les Cassandres de la déprime. Apparemment rien ne se passe : Dieu paraît loin et inactif, l’Église et l’action du Seigneur sont comme enfouies. Mais le Royaume est une réalité, encore en gestation, mêlée à notre vie quotidienne. Patience et confiance !
La première parabole, c’est donc pour affirmer que le Royaume se développe et grandit tout seul, malgré et contre tout. Est-ce à dire que nous avons à nous tourner les pouces sans rien faire ? Nous sommes embauchés à la vigne du Seigneur. Seulement, nous sommes des ouvriers « quelconques » (expression difficile à traduire : on a même traduits par ouvriers inutiles) dans le sens que notre collaboration avec Dieu n’est pas vaine parce que Dieu l’a voulue, mais qu’il peut se passer de nous. Que nous dormions, que nous soyons debout, il n’y a que Dieu qui donne la croissance. Ne gérons pas le Royaume comme nos multinationales (le Pape François y insiste) où on compte uniquement sur les ressources humaines : elles ne tiennent pas longtemps la route, la preuve c’est que l’histoire montre les empires financiers et politiques s’effondrer l’un après l’autre. Par contre, l’Eglise qui a commencé avec une petite poignée de disciples incultes, sans CV, sans formation en marketing ni diplôme en communication, sans le sou, avec pour chef Pierre qui a renié Jésus en disant qu’il ne le connaît pas, elle tient contre vents et marées. Non seulement elle tient encore, mais elle ne cesse de se développer, de se répandre : c’est l’enseignement de la 2ème parabole. Le sage Gamaliel avait raison (Act 5, 39).
La deuxième parabole parle de la graine de moutarde : la plus petite des graines pour les Juifs de l’époque de Jésus (Jésus y fait une autre allusion : « Si vous aviez de la foi grosse comme une graine de moutarde » ; certaines traductions utilisent le mot « sénevé »). De cette semence minuscule, presque invisible, surgira une plante qui grandira jusqu’à devenir ce grand arbre aux longues branches où les oiseaux du ciel viendront trouver abri, refuge, confort et bonheur (image classique de la Bible pour dire le grand rassemblement des nations). Le contraste est mis en évidence entre les modestes débuts et l’ampleur impressionnante en finale : comme le petit groupe réuni au Cénacle à la Pentecôte et l’Eglise aujourd’hui répandue sur toute la planète. Auparavant, Yahvé avait choisi Israël, le plus petit de tous les peuples. Puis ce fut le petit bébé de la crèche dans une grange d’un village insignifiant appelé Bethléem. Quand le Nazaréen commence sa prédication, on s’écrie : « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? » Quand il est sur la croix, le « tout est accompli » sonnait dans les oreilles humaines comme un « tout est foutu ». Voici la merveille de Dieu, voici la vraie puissance de Dieu : la Parole semée dans la pauvreté et l'humilité devient peu à peu un arbre immense à la dimension planétaire dont les branches sont assez étendues pour abriter l'humanité tout entière, toutes les religions, toutes les cultures, toutes les nations. St Paul disait que Dieu choisit ce qui est faible pour confondre les forts, ce qui est petit pour confondre les puissants, ce qui est fou pour confondre les sages.
La première parabole soulignait l’action invisible de l’Evangile dans le monde, la seconde souligne la disproportion entre les débuts insignifiants du Royaume et sa prodigieuse expansion à la fin des temps. Nous savons que la Parole de Dieu fait son œuvre dans le cœur et dans la vie, la nôtre comme celle de nos frères. Pourtant il y a des sceptiques pour rétorquer que rien ne se passe, qu’il y a si peu de choses qui changent dans la bonne direction. Il y a toujours la violence, l’injustice, la guerre, la barbarie sous toutes ses formes. Le tableau n’est pas reluisant même dans la « sainte » Eglise : non seulement la « pratique » baisse (moins de baptêmes et de mariages à l’église, vieillissement du clergé et des communautés paroissiales), mais elle est elle-même fréquemment secouée de gros scandales, même au plus haut niveau.
Si nous versons dans ce langage, le Seigneur, par ces deux paraboles, nous dit que nous n’avons rien compris au règne de Dieu. La croissance continue grâce au dynamisme interne de la Parole de Dieu. Mettons-nous plutôt au travail avec la conviction que le Seigneur a déjà donné la fécondité. Mettons en lui notre confiance absolue et non dans des hommes soi-disant « providentiels », ni dans des méthodes soi-disant éprouvées de la propagande, encore moins dans les finances. Malgré toutes les mauvaises informations dont nous abreuvent les médias, il y a un dynamisme du bien que nos sens ne savent pas capter. On dit en Afrique qu’un seul arbre qui tombe fait plus de fracas que toute une forêt qui pousse ?
Un des acquis du concile Vatican II, c’est le regard de l’Eglise catholique sur les autres Eglises et même sur les autres religions : à l’instar des Pères de l’Eglise, le concile y reconnaît des étincelles de la vérité divine. Un missionnaire au Rwanda a écrit un livre pour montrer les « valeurs et pierres d’attente » de nos religions traditionnelles africaines qui sont toutes monothéistes (il n’y a donc pas que le judaïsme, le christianisme et l’islam à professer un seul Dieu). La croissance du Royaume touche donc même ceux que nous croyons les plus éloignés de Dieu et qui n’en ont pas conscience ou le nient. Quelle idée de croire que Dieu ne s’intéresse qu’aux baptisés ! Le Père Philippe Bacq aime dire que « les fils du Royaume » sont partout ! Effectivement ils sont nombreux dans les autres religions et même chez des athées (ce qui ne veut pas dire qu’ils doivent le rester, qu’il ne faut pas leur porter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ).
La leçon de ces paraboles est une magnifique leçon de confiance : Dieu agit, faisons-lui confiance. Collaborons avec lui en favorisant, là où l'on vit, dans sa famille, son quartier, au bureau, tout ce qui va dans le sens d'une ouverture aux autres, de la paix, de la justice, de la fraternité universelle. Soyons à notre tour semeur d’amour, de joie, de foi. C’est ainsi qu’on prépare le terrain où la semence du Royaume viendra s’incarner. Et soignons la graine semée en notre propre cœur, laissons son dynamisme interne nous modeler en véritables et authentiques enfants du Royaume.
Amen.
Vénuste
DIMANCHE 2 JUIN 2024
HOMELIE DE GILLES
Fête du Saint Sacrement
ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans levain,
où l’on immolait l’agneau pascal,
les disciples de Jésus lui disent :
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs
pour que tu manges la Pâque ? »
Il envoie deux de ses disciples en leur disant :
« Allez à la ville ;
un homme portant une cruche d’eau
viendra à votre rencontre.
Suivez-le,
et là où il entrera, dites au propriétaire :
“Le Maître te fait dire :
Où est la salle
où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?”
Il vous indiquera, à l’étage,
une grande pièce aménagée et prête pour un repas.
Faites-y pour nous les préparatifs. »
Les disciples partirent, allèrent à la ville ;
ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit,
et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas,
Jésus, ayant pris du pain
et prononcé la bénédiction,
le rompit, le leur donna,
et dit :
« Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe
et ayant rendu grâce,
il la leur donna,
et ils en burent tous.
Et il leur dit :
« Ceci est mon sang,
le sang de l’Alliance,
versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis :
je ne boirai plus du fruit de la vigne,
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau,
dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes,
ils partirent pour le mont des Oliviers.
Homélie
En cette fête solennelle du saint-sacrement, autrement dit du Corps et du Sang de Jésus-Christ, les lectures qui précèdent l’évangile nous donnent à entendre un seul et même son de cloche : elles insistent toutes les deux sur la dimension sacrificielle de l’eucharistie, s’appuyant sur l’idée d’un rachat de nos péchés, payé par la mort de Jésus qui aurait versé son sang en sacrifice, comme celui des animaux dans la première alliance, tout cela pour « soi-disant » attirer les faveurs de Dieu ou encore pire pour « apaiser son courroux ». Il me semble que les paroles de Jésus lors de son dernier repas sont beaucoup plus riches que ce point de vue sacrificiel contre lequel Jésus lui-même s’est battu tout au long de son ministère public.
Alors comment comprendre autrement ces paroles de Jésus lors de son dernier repas ? Regardons l’évangile mais, une fois n’est pas coutume, sans nous laisser influencer par les lectures qui précèdent. Nous sommes au moment de la Pâque juive, fête qui commémore la sortie d’Egypte et plus précisément le passage (=pesah = Pâques) des hébreux de l’esclavage à la liberté. Pour célébrer le souvenir de leur libération, ils avaient l’habitude de manger un agneau (l’agneau pascal) et de bénir le pain et le vin qui l’accompagnaient. Tout cela, au cours d’un repas rituel en famille où l’on relisait le récit la sortie d’Egypte qui a eu lieu 1200 ans auparavant.
Jésus va utiliser ce même rituel pascal pour son dernier repas et en modifier le sens : le pain va devenir le symbole de son corps et le vin celui de son sang. Remarquez en passant que dans la version de Marc, il n’est pas question de verser son sang pour le pardon des péchés, mais simplement « pour la multitude », c’est-à-dire pour tous. Jésus a certainement conscience qu’il vit son dernier repas avant d’être arrêté et certainement tué, ce moment revêt donc un caractère solennel. En prononçant ces paroles, il se compare à de la nourriture, mais pas n’importe quelle nourriture, celle justement qui commémore la passage de l’esclavage à la liberté. On peut y voir une allusion évidente à son passage de la mort à la vie, mais il ne nous est pas interdit de penser que Jésus fait écho à sa vie terrestre, où il a dû passer lui-même de l’esclavage à la liberté.
Je m’explique : Jésus est venu dans le monde, entièrement humain, donc il a forcément été pris lui aussi dans les formatages et conditionnements humains que nous connaissons bien : il a dû apprendre à se défaire progressivement de son égo (de l’image de lui-même) pour accéder à son être profond et retrouver son unité naturelle avec Dieu. Il a donc dû se libérer de son égo pour devenir pleinement fils du Père et il faut dire qu’il a plutôt bien réussi. Il a dû mourir à son égo, rompre avec ce conditionnement humain qui nous empêche d’être nous-même, pour advenir à son être originel, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est ce chemin qu’il a enseigné à ses disciples et qu’il nous invite à faire à sa suite.
Par conséquent, quand il se compare à un pain rompu, (le texte grec dit bien que Jésus « brisa » le pain, « klao » en grec), il parle du travail qu’il a dû faire pour briser son égo, rompre cette gangue des conditionnements humains pour devenir pleinement lui-même et pleinement libre. « Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » c’est-à-dire, mon corps libéré de son égo, mon être profond, mon moi divinisé. Quand il donne son corps libéré de son égo à manger aux disciples, c’est comme s’il leur disait : « Prenez et nourrissez-vous de ce que je suis devenu, de mon être plein et entier, lié à Dieu et pleinement vivant ». Manger son corps, c’est donc mastiquer et digérer ses paroles, assimiler son enseignement, prendre le même chemin que lui, nous libérer de notre égo pour devenir à notre tour pleinement nous-même et de véritables enfants du Père, à l’image de Jésus.
Il en va de même pour l’invitation à « boire son sang » : c’est un langage symbolique qui nous invite à vivre de sa vie (le sang étant le symbole de la vie), à ne faire qu’un avec lui, c’est entrer dans cette attention à la présence divine au plus intime de nous-même, c’est vivre cette ouverture radicale du cœur, c’est vivre de la vie du Christ au cœur de ma vie quotidienne, en aimant comme Jésus a aimé, et Dieu sait que sa façon d’aimer ne fut pas un long fleuve tranquille. Cela nécessite de mourir à bien des choses : à notre tentation de dominer, de possèder au lieu de donner, de prendre au lieu de recevoir, bref de donner sa vie et non de vouloir la garder pour soi-même. C’est cela que signifie pour moi le sang versé pour la multitude, c’est accepter de mourir à nous-même pour être tourné vers les autres et vers Dieu. Et le sang versé pour la multitude est appelé « sang de l’alliance » ce qui signifie que ce don de soi, libéré de son égo, est fait pour faire des liens, pour la relation et le vivre ensemble.
En fait, quand Jésus prononce ces mots lors de son dernier repas, je crois qu’il ne parle pas de sa mort à venir mais de ses morts passées : de tous ces moments où il a dû mourir à son égo pour devenir un peu plus fils de Dieu chaque jour. la bonne nouvelle, c’est que ce qu’il a fait est désormais possible pour nous aussi, Jésus nous a ouvert le chemin et nous invite à le suivre, c’est-à-dire à incarner dans notre corps ses paroles et son enseignement. Voilà pourquoi, il dit de lui-même qu’il est « le chemin, la vérité et la vie », car tout homme qui emprunte ce chemin-là sera en vérité et vivant comme Jésus.
Du coup, vous commencez à voir la grandeur et l’importance de l’acte que nous posons en allant communier au corps et au sang de Christ : après avoir écouté sa parole et son enseignement, nous décidons de faire le chemin qu’il a fait : celui de quitter notre égo pour accepter d’être nous-même, humble, pauvre mais vrai et enfin capable de nous laisser aimer tels que nous sommes. Lorsque nous allons communier nous incarnons dans notre chair le chemin que Jésus a fait : un chemin de libération, nous sommes alors une nouvelle incarnation du verbe, nous aussi et nous devenons progressivement jour après jour, communion après communion, un peu plus comme le Christ : des fils bien aimés du Père, à son image et à sa ressemblance.
Oui, la fête que nous célébrons aujourd’hui est une grande fête, c’est la fête de notre capacité retrouvée à devenir enfant de Dieu. Et s’il y a quelque chose à sacrifier, c’est tout simplement notre égo auquel nous sommes invités à ne plus nous identifier, pour advenir progressivement à nous-même.
Voilà je crois, quel est le vrai chemin qui conduit à la vie.
Gilles Brocard
DIMANCHE 26 MAI 2024
HOMELIE DE VENUSTE
Fête de la Trinité
Deutéronome 4, 32… 40 : le Dieu d’Israël s’est fait connaître dans l’Histoire, il n’est pas une vue de l’esprit, il n’est pas le fruit de cogitations ni de soliloques, on ne le trouve pas de façon rationnelle. Dieu se révèle à travers des gestes, des contacts ; il communique avec l’homme, il se communique à lui. C’est un Père plein d’attentions. De mémoire d’homme, « est-il arrivé quelque chose d’aussi grand… ? »
Romains 8, 14-17 : un court texte où les 3 Personnes divines sont présentes. Dieu n’est pas défini en termes de pouvoir (ou d’énergie) devant lequel on serait esclave, mais en termes d’amour : le chrétien est déjà plongé dans l’intimité trinitaire ; il appelle le Père par un nom de tendresse, Abba (littéralement « petit papa chéri »), que lui inspire l’Esprit Saint, il est cohéritier du Fils, il est habité par l’Esprit Saint.
Matthieu 28, 16-20 : Jésus envoie les disciples baptiser, c’est-à-dire donner la filiation à tous les hommes de toutes les nations. C’est son pouvoir qu’il transmet ainsi. L’universalité de ce don est souligné par la répétition : tout pouvoir… toutes les nations… tous les commandements… tous les jours…
La Trinité ? Nous n’avons pas d’idée satisfaisante là-dessus pour notre esprit cartésien. Mais nous savons que, avec la résurrection, c’est l’originalité, la spécificité du christianisme. La dimension trinitaire est l'âme même du culte chrétien ; c’est le dogme central de notre foi.
La révélation de la Trinité a pris du temps selon la pédagogie divine. Qui donc est Dieu ? C’est la question que l’humanité se pose depuis le premier jour. Il faut laisser Dieu nous « souffler » lui-même la réponse... Nul ne peut connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas lui-même. La Trinité : l’aboutissement de la Révélation en Jésus Christ. Il a fallu toute la durée de l’Ancien Testament pour se libérer du polythéisme (les Olympes surchargés) et croire en un Dieu unique (monothéisme pur). Une étape intermédiaire fut celle de l’hénothéisme : on professait un seul Dieu d’Israël, mais on concevait que les autres peuples avaient leurs dieux. C’est pendant l’Exil à Babylone, semble-t-il, qu’Israël découvrit que Dieu est le Dieu unique de tout l’univers. La découverte du mystère de la Trinité sera la dernière étape de la révélation de Dieu à son peuple. Il était impossible pour l’homme d’entendre, en une fois, le double message : Dieu est UN et il est en trois Personnes. La première étape de la pédagogie de Dieu a donc été de se révéler d’abord comme le Dieu Unique (et c’est l’objet de l’Ancien Testament) ; la deuxième étape sera l’objet du Nouveau Testament : ce Dieu UN n’est pas solitaire, il est une communion d’amour entre trois Personnes. Ces trois personnes distinctes sont d'une seule nature : divine. Cette Trinité se définit aussi par les relations entre elles : relation entre Père et Fils, entre Esprit et Père, entre Fils et Esprit. Il a fallu à l'Eglise quatre siècles pour aboutir à la conception trinitaire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dieu se révèle progressivement à travers son histoire avec son peuple. Comme toute histoire d’amour : c’est progressivement que les amis se découvrent, apprennent à s’aimer et mieux se connaître.
Il a fallu des siècles également pour que la liturgie chrétienne intègre la fête de la Trinité. Au départ, l’Eglise n’éprouvait pas le besoin de consacrer un dimanche à la Trinité, puisque chaque dimanche et chaque liturgie sont trinitaires. A une époque où l’on avait un peu oublié que chaque messe (sa prière eucharistique en particulier) était une prière au Père par son Fils dans son Esprit, s’imposa une fête de la Trinité. Elle se répandit à partir de 1030 et le pape Jean XXII va l’imposer à tout l’Occident en 1334 après 5 siècles qu’elle n’était qu’une messe votive. On ne sait pourquoi elle fut placée au dimanche suivant la Pentecôte.
On n’est pas à l’aise avec le mot « trinité » qui ne se trouve nulle part dans la Bible, même pas dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que l’Eglise est arrivée à parler de Trinité ? A la suite de Jésus bien sûr qui parlait de « mon Père » (non de façon dogmatique) de façon privilégiée en s’en faisant l’égal, une « énormité » pour ses auditeurs juifs qui en feront un des motifs de sa condamnation (ils l’ont donc bien compris sans l’accepter) ; il parlait aussi de l’Esprit qu’il donna à ses disciples le jour de la résurrection. La « définition » du dogme se fera à partir de l’usage liturgique, à partir de deux usages en particulier : l’Eglise baptise au nom de la Trinité et la prière chrétienne est trinitaire par définition.
Nous venons de l’entendre dans l’évangile de cette liturgie, Jésus envoie ses disciples par le monde entier, baptiser tous ceux qui croiront. C’est ce qu’ils vont faire à partir du jour de la Pentecôte déjà. Jésus avait donné la formule du baptême : « baptisez-les au nom [un singulier] du Père, et du Fils et du Saint Esprit ». Les apôtres et les premiers chrétiens ne répétaient pas la formule tout bêtement. D’après les textes qui nous sont parvenus, les premiers chrétiens faisaient bien la différence entre les 3 Personnes et ils avaient compris que les trois ont une « égale dignité » : il n’y a pas un qui serait supérieur aux 2 autres, ni supérieur, ni inférieur, ni antérieur. Ils vont utiliser la formule du baptême, avec la conscience nette que le Père n’est pas le Fils, que le Fils n’est pas le Saint Esprit, que le Saint Esprit n’est pas le Père ; que les trois ne sont pas des appellations floues mais bien des Personnes ; tout en gardant la foi de leurs pères en un Dieu unique (il ne s’agit pas de trithéisme). Ils avaient l’idée juste de la Trinité sans utiliser le mot, sans avoir les formules qui seront « définies » par les conciles, spécialement le concile de Nicée (en 325) et le concile de Constantinople (en 381) qui vont « bétonner » le Credo chrétien que les baptisés de toutes les Eglises (pas seulement catholiques) récitent tous les dimanches dans leur liturgie. L’usage veut, depuis l’époque des apôtres, que celui qui va être baptisé, professe d’abord la foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint, afin de donner la preuve que sa foi est « orthodoxe », c.-à-d. ne connaît pas de déviation par rapport à la tradition apostolique. Cet usage deviendra une norme surtout au moment où les hérésies vont se développer à propos du Fils, l’Homme-Dieu, ce qui explique le fait que dans le Credo, aussi bien que dans le « Symbole des Apôtres », la partie qui concerne le Fils est beaucoup plus développée. Paradoxalement, ce sont les hérésies qui ont amené l’Eglise à trouver des formules précises de la doctrine de la Trinité.
En plus de la célébration du baptême, nous avons également la célébration eucharistique qui est trinitaire, à toutes les étapes de la liturgie. A commencer par le signe de croix : c’est la plus courte des professions de foi en la Trinité, mais déjà toute une théologie. Il y a la salutation, empruntée à St Paul, qui nomme les trois Personnes divines. Les oraisons, comme toute prière chrétienne, sont trinitaires : toutes les prières, surtout la « collecte » sont adressées au Père (sauf quand on veut mettre en relief le rôle du Fils ou de l’Esprit Saint dans notre salut), par le Fils et dans l’Esprit Saint. Il y a le Gloria qui, comme le Credo, a une structure trinitaire. Il y a la prière eucharistique : unis au Fils, nous offrons au Père, le pain et le vin qui deviennent Corps et Sang du Christ par l’action du Saint Esprit le Sanctificateur (l’épiclèse demande que l’Esprit vienne sanctifier le pain et le vin ; ce n’est donc pas, comme on le disait dans le temps, le prêtre qui consacre et fait descendre le Christ sur le pain et le vin : « sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu’elles deviennent pour nous le Corps et le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur » ; le prêtre tient la place de Jésus, mais c’est l’Esprit qui descend sur les offrandes pour les sanctifier). Et puis il y a une épiclèse sur l’assemblée. Il y a la « doxologie » qui termine la partie eucharistique proprement dite : « par lui (le Fils) avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint Esprit… » Et enfin la bénédiction.
Nous croyons que notre Dieu n’est pas un dieu solitaire. Le Christ nous l’a révélé Amour. Or qui dit amour, dit échange, réciprocité, dialogue, communion, communauté d’amour. Un seul Dieu, trois Personnes : ce n’est pas de l’arithmétique, c’est notre foi. De même qu’il ne fut pas un temps où Dieu n’était pas (puisque éternel), de même il ne fut pas un temps où il ne fut pas amour-communion. Ce n’est pas non plus tout un panthéon : Dieu est un, unique, dans la Trinité des Personnes divines.
Est-ce qu’on peut saisir la Trinité par le raisonnement, par la logique ? Est-ce qu’on peut « connaître » une personne avec la raison ? Un portrait-robot peut-être, mais pas le cœur de la personne. Connaître une personne, ce ne peut être qu’en l’aimant. De même pour Dieu. Il faut une relation, une communication, une fréquentation : il faut « se brancher » pour qu’il y ait un flux et un reflux, de sentiments et de vie. Si Dieu est un mystère (l’homme est déjà mystère pour lui-même), pour le comprendre, nous sommes invités à y prendre part, puisque plongés en Lui par le baptême ; nous sommes invités à entrer dans cette histoire de découvertes et d’alliances progressives, les unes après les autres et toujours plus profondes. D’où la nécessité de la prière. Dieu « trine » n’est pas une équation à trois inconnues. Dieu on le prie, même si la trinité est un langage théologique, qui n’incite pas nécessairement à la prière. C’est dans le culte qu’on récolte la foi, pas en bibliothèque. On prie volontiers le Père, on sait s’adresser au Fils également comme Dieu. Il faudrait apprendre à s’adresser à l’Esprit Saint comme Dieu, à l’école de l’Eglise primitive.
C’est un bel exercice que nous pouvons faire dans notre prière privée : nous adresser alternativement à chaque Personne divine. Résultat : on remarque que ce ne sont pas des idées, mais bien des Personnes, qui aiment et veulent être aimées. Dieu notre Père, Dieu notre Frère, Dieu notre Amour. Résultat : nous nous sentons en famille, lieu d’amour par excellence, lieu du donner et du recevoir. Osons l’amour, osons aimer Dieu. Aujourd’hui, essayons de prier de façon attentive à ces différents moments de la liturgie, conscients que nous parlons aux 3 Personnes de la Trinité.
Amen
Vénuste
DIMANCHE 19 MAI 2024
HOMELIE DE VENUSTE
Ça a fait du bruit !
Actes 2, 1-11 : le grand événement de la Pentecôte qui va tout changer, non seulement dans la vie des apôtres, mais dans toute l’histoire de l’humanité. « … ça a fait du bruit, ça a chauffé, ça a causé ! » « Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint, ils se mirent à parler… nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu ». Depuis lors ça n’arrête pas, puisqu’ici aujourd’hui, nous proclamons dans notre langue les merveilles de Dieu. Ce ne fut pas un feu de paille puisqu’il continue d’embraser l’univers entier.
Galates 5, 16-25 : pour Paul, l’homme ne peut vivre que de 2 façons. Soit il vit selon la chair (le mot signifie la faiblesse humaine, sa mortalité, quelques fois le dérèglement sexuel, mais surtout l’opposition à Dieu) et les œuvres de la chair conduisent à la mort. Soit il vit selon l’Esprit et les œuvres de l’Esprit sont les œuvres de Dieu, des œuvres de vie.
Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 : le Défenseur est venu rendre témoignage à Jésus et conduire les chrétiens à rendre témoignage eux aussi. Lui, l’Esprit de vérité, il nous guide vers la vérité tout entière. La Pentecôte ne se répète pas, elle continue.
Pentecôte - du grec : pentecostè, cinquante - le cinquantième jour (7x7+1) après Pâques, était, chez les Juifs, avec la Pâque et la fête des Tentes, une des trois grandes fêtes de pèlerinage. Une fête de la récolte du blé : à cette occasion, on venait offrir une gerbe de la nouvelle récolte, c’était donc la fête de la moisson, de l’abondance, et on remerciait le Ciel d’avoir donné la récolte de l’année dont on offrait les prémices. Plus tard la fête est devenue une commémoration de l’Alliance du Sinaï. La fête explique la grande affluence à Jérusalem de beaucoup de pèlerins : « des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel », des pèlerins qui parlaient toutes sortes de langues ; ce qui devait être une tour de Babel sera le miracle de la langue de l’Esprit : tout le monde entend les apôtres annoncer Jésus Christ et proclamer les merveilles de Dieu chacun dans sa langue maternelle.
Mais, alors que Pâques et Pentecôte n’avaient pas de rapport direct dans le culte juif, la liturgie chrétienne les a unies. Pendant les premiers siècles du christianisme, on n’a jamais considéré le jour de la Pentecôte comme une fête à part, mais comme le dernier jour de la grande fête de Pâques qui dure 50 jours. Le lien entre Pâques et Pentecôte est mis en évidence par l’évangéliste St Jean : pour lui, Pâques, Ascension, Pentecôte, tout cela se passe le jour même de la résurrection : « il souffla sur eux et leur dit : « recevez l’Esprit Saint… » Les cinquante jours n’en sont qu’un et ce jour de Dieu ne s’arrête plus.
Tout le temps pascal est le temps fort de l’Esprit. Nous avons passé ces 50 jours de Pâques (on ne dit plus « après » Pâques) à lire les Actes des Apôtres dans nos liturgies les dimanches et les jours de semaine. Toute personne qui a prêté attention à cette espèce de chronique des débuts de l’Eglise, a bien compris que le même Esprit de force et de puissance qui a conduit Jésus, est le même qui a conduit les Apôtres avec la même puissance et la même force. C’est ainsi que l’Eglise a pu naître et se développer très rapidement : c’est parce qu’ils étaient remplis de l’Esprit Saint. L’événement de la Pentecôte ne peut donc être séparé de l’événement de la Pâque : le don de l’Esprit aux apôtres est manifesté au début et à la fin des cinquante jours. La Pentecôte n’ajoute rien à Pâques, elle n’en est pas indépendante : la Pentecôte accomplit le mystère pascal, en ravivant le don de l’Esprit. C’est le déploiement au niveau planétaire de ce que Pâques nous a apporté. C’est la moisson abondante cueillie sur l’arbre de la croix. C’est l’Eglise qui sort à la rencontre de l’histoire et de l’humanité. C’est le don répandu sur l’univers. Aujourd’hui nous continuons à accueillir le temps de la Pentecôte qui se poursuit de dimanche à dimanche.
Mais l’Esprit Saint est le grand inconnu. Difficile de dire qui il est, on peut tout au plus décrire ses actes et ses « dons ». Le Christ lui-même parle de lui en nous prévenant de ce qu’il va faire pour nous et en nous. On peut dire ce qu’il nous rend capables de faire, et même ce que nous ne pouvons pas faire (être) sans lui. Il était présent en force et puissance dans la vie et l’œuvre de Jésus, il est présent de la même façon dans la vie de l’Eglise. On dit souvent que le livre des Actes des Apôtres est l’Evangile de l’Esprit : il fait le récit de ce que l’Esprit a accompli comme œuvre dans la vie et l’œuvre des apôtres, pour faire naître l’Eglise, la répandre aux quatre coins du monde et la fortifier. Descendre, fondre, venir, se poser, pénétrer, remplir, se répandre… ce sont là les verbes qui expriment l’action de l’Esprit dans le cœur de chaque chrétien et dans la vie de l’Eglise entière. Le résultat, c’est de connaître (selon l’extrait de l’évangile d’aujourd’hui), d’être dans la vérité toute entière, pas pour satisfaire une certaine curiosité intellectuelle, c'est pour témoigner avec l’Esprit (la 1ère lecture donne l’expression « proclamer les merveilles de Dieu ») de sorte que tout un chacun comprend dans sa langue maternelle.
Sa première manifestation très remarquée est la Pentecôte. Irruption explosive de l’Esprit dans la vie des apôtres. Quelque chose de fort se passe, « soudain », qui transforme ces gens peureux en témoins intrépides. Dès ce moment, l’évangile n’est plus enfermé derrière les portes verrouillées d’un refuge, il n’appartient plus à un groupuscule d’initiés apeurés : l’Esprit les projette littéralement sur la place publique pour que tous les peuples puissent entendre la Parole de Dieu et que la diversité des langues ne fasse plus obstacle à l’annonce de la Bonne Nouvelle. Quelque chose de fort s’est passé : plus rien ne les fera taire, plus rien ne les arrêtera, les voilà qui parlent avec audace et assurance.
Quelque chose s’est bien passé, peut-être pas « soudain » en un coup de vent, peut-être au cours d’une lente évolution, une lente maturation, en tout cas une expérience forte qui signa la naissance de l’Eglise missionnaire. Luc décrit cela comme un événement au cours duquel la Loi est remplacée par l’Esprit hôte des coeurs, la loi n’est plus inscrite sur la pierre, elle est cette flamme d’amour qui se divise et se pose sur chaque apôtre : Luc met en scène un bruit venant du ciel, comme un violent coup de vent, une sorte de feu, et des langues. Ce sont là des images traditionnelles (de théophanie = manifestation divine), comme justement au mont Sinaï (Exode 19) lors du don de l’Alliance (de la Loi) que les Juifs célébraient 50 jours après la Pâque. Dieu se manifeste souvent dans le vent, dans la fumée ou la nuée, dans des sons puissants. L’auteur des Actes des Apôtres a voulu placer au début de la Nouvelle Alliance, quelque chose d’aussi fort qu’au Sinaï lors de la 1ère Alliance. Quelqu’un disait qu’en ce jour de la Pentecôte, « ça a fait du bruit, ça a chauffé, ça a causé ! » C’est l’Esprit qui descend en surabondance. Les fruits de la nouvelle moisson, c’est une joie enivrante. Imaginez les disciples qui sortent du lieu où ils se cachaient, qui font irruption dans le temple un peu en trouble-fête ; on les prend pour des soûlards, mais on est surpris de les comprendre peu importe la langue maternelle, ils n’ont pas besoin de traduction simultanée : ils parlent la langue de l’amour, autre chose que la tour de Babel. Depuis lors, ce sont des hommes nouveaux qui vont parcourir toute la terre en convertissant des foules. C’est l’Esprit qui opère en eux, qui est à l’œuvre dans la diversité des charismes.
La Pentecôte devrait être permanente dans l’Eglise, aujourd’hui aussi. Difficile à vivre, car nous n’avons pas prise sur l’Esprit Saint. Aussi l’oublions-nous pour le remplacer par le culte des saints (et du pape). Nous retombons dans ce que le Christ voulait nous éviter ! Prenez une fois votre missel : les fêtes des saints vont toujours en augmentant, la Sainte Vierge en a 25 ! Alors que l’Esprit Saint n’a que le jour de la Pentecôte ! Par contre, lisez le livre des Actes des Apôtres pour voir combien l’Esprit Saint était vraiment le « Paraclet », c.à.d. celui qu’on appelle à l’aide, celui qui prête assistance pour les grandes et les petites choses. L’apôtre se sent « poussé » par l’Esprit, « porté » par lui, animé, inspiré, guidé. Il n’y a pas une prière qui ne soit une prière de l’Esprit, car nous ne savons pas prier, c’est l’Esprit qui nous vient en aide pour nous inspirer une vraie prière chrétienne. L’apôtre ne prêche pas sans que ce soit dans l’Esprit, car nul ne peut dire « le Christ est Seigneur », si ce n’est par l’Esprit. Il n’y a pas une réunion qui se fait sinon dans l’Esprit, car depuis l’Ascension, c’est lui qui est le chef de la communauté (Eglise), le chef des opérations. Le chrétien, comme l’Eglise entière, vit de l’Esprit. Dieu que les religions aiment placer « au plus haut des cieux » où elles le maintiennent transcendant, inaccessible, est désormais plus que proche puisqu’il est le Dieu en nous, il habite chacun et agit en nous tant qu’on est docile à son action. Il n’y a donc plus de distance entre Dieu et nous.
Alors qu’avons-nous fait de l’Esprit Saint, reçu à profusion au baptême et à la confirmation. Il faut se rappeler que Jésus lui-même était « poussé » par l’Esprit en tout ce qu’il faisait. Il ne s’agit pas de passivité, quand nous disons qu’il faut se laisser conduire par l’Esprit : St Paul utilise (2ème lecture) les expressions « marcher dans l’Esprit », « se laisser conduire par l’Esprit », « suivre l’Esprit » dans ce combat sans merci contre la chair et le péché pour nous en libérer. Essayons de laisser l’Esprit Saint agir en nous, d’être attentifs à sa voix (à son souffle), de le laisser nous pousser à prier, à méditer la Parole, à exercer la charité. Les merveilles de Dieu qu’il nous faut proclamer, ce ne sont pas des anecdotes que nous entendons des autres, c’est l’expérience spirituelle, le cheminement spirituel de chacun, l’œuvre de l’Esprit en notre cœur et en notre communauté. S’il n’y a pas de chemin parcouru, c’est que nous nous sommes déconnectés de l’Esprit. Si nous ne sommes pas poussés à l’action et à l’engagement, c’est que nous nous refusons à être portés par l’Esprit. Si nous ne savons pas prier ou si nous ne prions qu’avec les mots des autres, c’est que nous ne nous laissons pas inspirer par l’Esprit. Laissons-le nous habiter, éduquer notre foi, nous porter dans le quotidien. De grâce, disait st Paul, n’éteignez pas l’Esprit, car alors on se remet sous l’emprise de la chair… et c’est la mort spirituelle assurée.
Viens Esprit d’amour, de paix, de joie, d’unité, de vie ; Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, viens !
Amen
Vénuste
DIMANCHE 12 MAI 2024
HOMELIE DE VENUSTE
Son commandement, c'est l'amour !
Actes 10, 25… 48: « la Pentecôte des païens ». Pierre est conduit par Dieu chez les païens ; lui qui est juif, il brise un tabou, il entre dans leur maison sans avoir peur de contracter l’impureté ; il a la surprise de voir l’Esprit Saint se répandre sur la famille de Corneille, comme à la Pentecôte, « tout comme à nous ». C’est la 1ère annonce auprès des non-Juifs. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Dieu veut l’Eglise universelle, catholique.
1 Jean 4, 7-10 : « l’amour vient de Dieu… Dieu est amour. » Aimer, c’est ressembler à Dieu, c’est connaître Dieu et être son enfant. Dès lors, il faut aimer comme Dieu.
Jean 15, 9-17 : même enseignement que l’épître. L’amour a force de loi au même titre que le Décalogue. Ce n’est pas une option. Cependant, nous n’y obéissons pas comme des serviteurs, mais comme des amis. Le Christ s’étend sur ce précepte la veille de sa mort, ce qui en fait un testament.
Pendant le temps pascal, nous avons lu l’évangile selon St Jean, dans sa partie qu’on appelle « le discours d’adieu » ; c’est pour cela que l’extrait lu commençait par les mots (ajoutés dans la lecture liturgique) : « à l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père » (le mot « pâque » signifie « passage »). C’est donc un testament (spirituel), ce sont « les dernières volontés » du condamné à mort qu’était Jésus, les dernières recommandations, maintenant que les disciples vont être privés de sa présence physique et que ce sont eux qui vont désormais porter la Bonne Nouvelle : Jésus dit l’essentiel de son message. Il parle de l’amour : l’amour du Père pour lui, cet amour qu’il déverse en abondance sur les siens, cet amour que ceux-ci doivent avoir pour le Père et entre eux, un amour en vérité et en actes. Quelques exégètes ne sont pas d’accord qu’on parle de testament dans le cas de Jésus parce qu’il est toujours vivant (le testament c’est dans le chef de celui qui va mourir et disparaître définitivement).
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour… » L’extrait de dimanche dernier nous a déjà introduit dans ce concept de « demeurer », comme les sarments qui doivent rester sur la vigne sous peine de mourir et de sécher, demeurer étant la condition sine qua non pour qu’ils ne dépérissent pas et qu’ils portent des fruits en quantité et en qualité (fécondité spirituelle, efficacité apostolique, pastorale). L’extrait d’aujourd’hui explique l’image de la vigne, nous comprenons que la sève, c’est l’amour, la vie féconde que Jésus fait circuler dans les sarments que nous sommes. Remarquons encore, dans cet extrait, la fréquence du mot « demeurer », et cette fois-ci jumelé aux termes « amour », « aimer », « ami » (22 fois dans cet extrait !).
« Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Deux choses sont à souligner dans cette phrase : Jésus fait de l’amour un commandement, un commandement bien à lui (« mon ») et il y a le « comme » qui spécifie l’amour typiquement chrétien pour bien montrer qu’il doit aller plus loin que l’amour humain jusqu’à la mesure de l’amour divin (la mesure ? St Bernard disait que la mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure). Essayons de comprendre ces deux choses.
Est-ce qu’on peut faire de l’amour un commandement ? L’amour est par essence libre et spontané, sans contrainte aucune (le commandement oblige). On dirait qu’il est instinctif, naturel. Oui, c’est vrai, l’amour ne souffre d’aucune contrainte extérieure. Mais l’amour peut se forcer, en ce sens qu’il comporte un effort de volonté, un engagement à la fidélité, un acte de foi, du moins l’amour que nous demande Jésus. Il y a des gens aimables, sympas : c’est instinctivement qu’on les aime. Il est tout à fait naturel d’avoir un sentiment fort pour un bienfaiteur, par reconnaissance. C’est tout autre chose que d’aimer quelqu’un de pas du tout aimable, de désagréable, insupportable, sans manières : on se demande pourquoi il faudrait l’aimer, instinctivement on l’évite, même si on n’a pas de haine contre lui, il y a répulsion naturelle. De même quelqu’un qui vous a fait du tort, un ennemi : on ne peut même pas le supporter, on prend ses distances, on détourne le regard. Eh bien, le Christ nous dit qu’il faut aimer même celui-là qui a tout, qui fait tout pour qu’on le haïsse ou du moins qu’on l’évite, ne fût-ce que pour ne pas envenimer la situation. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent, nous dit le Maître. Ne les évitez pas, allez vers eux, même si vous êtes la victime de leurs torts, faites le premier pas vers la réconciliation et la pleine entente, pour faire la paix et construire une nouvelle relation forte… d’amour.
Et c’est là que nous comprenons le « comme » : c’est la mesure de l’amour qui nous est commandé. D’ordinaire, nous avons l’habitude de nous présenter comme la mesure de toute chose, nous disons (et l’Ancien Testament ne fait pas mieux) qu’il faut aimer le prochain comme on s’aime soi-même… c’est un réel exploit d’arriver à s’aimer soi-même et à aimer l’autre comme on s’aime (on a toujours tendance à vouloir ajouter « en vérité » : s’aimer et aimer vraiment). Le Seigneur nous demande d’aimer comme il nous a aimés. Et il nous met dans la confidence (puisque nous ne sommes plus serviteurs et qu’entre amis, on ne se cache plus rien) en nous révélant qu’il nous aime comme il est aimé lui-même par le Père. Il demeure dans cet amour, il nous introduit dans cette intimité. Il nous plonge dans cet océan d’amour pour en être pleinement imprégnés afin de le vivre avec les autres. Comme je vous ai aimés. S’il nous le demande, il sait que nous en sommes capables, il ne doute pas de nous, ne doutons pas de nous-mêmes !
« Comme je vous ai aimés. » En fait nous avions tout, nous avons tout fait pour ne pas être aimables par Dieu. Mais Dieu n’a pas épargné son Fils, il l’a livré pour nous. St Paul disait qu’à la limite, on peut mourir pour un homme de bien. Hommes de bien, nous ne l’étions pas du tout, nous ne le sommes jamais, puisque nous sommes, continue-t-il, coupables et pécheurs. Difficile à comprendre : humainement, c’est de la folie, il faut être Dieu pour arriver jusque là, aimer des gens qui vous offensent continuellement, les aimer jusqu’à mourir pour eux ! Et Dieu nous demande de faire de même, de vivre l’amour humainement insensé. Aimer tout le monde, même le plus détestable. L’aimer comme Dieu l’aime profondément malgré ce qu’il est, pour qu’il change. L’aimer parce que nous-mêmes nous sommes aimés du même amour. L’aimer en acte, pas seulement platoniquement en pensée. L’aimer jusqu’à donner la vie pour lui : pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Cet amour dépasse le seul sentiment affectif spontané ou une charité vaguement compatissante ou un devoir à accomplir : aimer de manière authentique et durable. Le fait de reconnaître, de se savoir aimé de Dieu, donne le bonheur d’aimer à son tour : aimer Dieu et tous les bien-aimés du Père. Aimer et être aimé = le vrai bonheur. Une grâce qu’on reçoit de Dieu. Une responsabilité aussi : faire le bonheur de notre prochain.
« Je ne vous appelle plus serviteurs… maintenant vous êtes mes amis. » Encore une chose difficile à comprendre humainement. Car dans notre mentalité, l’homme sert Dieu (devoirs et obligations), surtout quand il s’agit de se racheter pour ses nombreux manquements. Jésus vient renverser ce genre de relation que nous cultivons envers Dieu. Nous devons abandonner cette mentalité d’esclave, pour nous sentir fils et filles de Dieu, amis, frères et sœurs de Jésus. Là nous avons à opérer une révolution dans nos têtes parce qu’on nous a habitués à « servir » Dieu, mais jamais à l’aimer : une fausse pudeur nous empêche de concevoir que nous pouvons aimer Dieu, nous nous contentons d’être ses serviteurs, dociles et prompts à faire sa volonté, pour « mériter », en récompense, sa grâce et son salut. On a déserté l’Eglise (paradoxe ! on venait plus nombreux quand, dans les sermons, elle menaçait d’enfer et de feu éternel) quand elle a parlé plus de l’amour de Dieu que de sa justice sévère, de ses punitions ! Le Dieu de Jésus Christ n’est pas un dieu gendarme, il aime et quémande notre amour ; il s’est tué à nous prouver son amour. En l’aimant à notre tour, nous ferons alors un meilleur service. Nous accomplissons sa volonté, parce que cette volonté d’amour est notre bien, notre paix définitive, notre joie parfaite. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. »
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis… » Encore un malentendu à éclaircir. Nous sommes habitués à dire que nous sommes à la recherche de Dieu, que c’est l’homme qui cherche Dieu (l’un ou l’autre athée dira même que c’est l’homme qui se crée un dieu). Trouver Dieu serait une espèce de récompense, après une vie d’effort, de pénitence, de dure ascèse. La religion chrétienne nous dit, au contraire, que c’est Dieu qui prend l’initiative d’aimer et de chercher à joindre l’homme. C’est sur le fait que ce n’est pas nous qui avons d’abord aimé Dieu, (c’est lui qui nous a aimés le premier), que se base la coutume de baptiser les petits enfants (de leur donner la sainte communion également, chez les Orientaux) : ils ont déjà le droit de recevoir le signe de l’amour, puisqu’ils sont déjà aimés de Dieu, les conditions favorables à l’accroissement de cet amour en eux étant évidemment garanties ; ce n’est pas davantage l’adulte qui mérite le baptême, tout au plus acceptera-t-il, en adulte, l’amour déjà donné. C’est ce qu’a compris Pierre quand il a baptisé le centurion Corneille et sa famille : l’Esprit Saint l’a précédé en descendant sur ces païens, « comme à nous », comme sur les apôtres au Cénacle ; Pierre en a conclu qu’on ne peut pas refuser le baptême d’eau à ceux qui ont reçu l’Esprit Saint sans demi-mesure, en plénitude. L’amour de Dieu est premier, son amour ne dépend pas du nôtre, et il est « de toujours à toujours » ; quand bien même je le refuse, Dieu ne s’arrêtera pas de m’aimer.
Voyez comme ils s’aiment ! Le Christ avait dit que le monde nous reconnaîtra comme ses disciples à la manière dont nous nous aimons. Est-ce bien le cas ? Nous ne nous haïssons peut-être pas, mais est-ce que nous nous aimons… vraiment… comme il nous aime ? Par conséquent, est-ce que nous sommes vraiment ses disciples ? Est-ce que nous demeurons dans son amour ? Est-ce que notre Eglise est amour avant d’être organisation ? Que son amour abonde dans notre cœur pour le donner à notre tour, à tous les hommes que Dieu aime, sans frontières, sans conditions, sans exclusive. Un amour à cultiver.
Amen
Vénuste